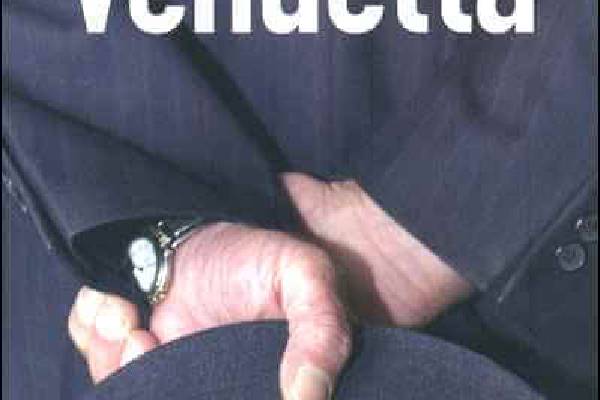
Vendetta, c’est d’abord une histoire de familles, de deux familles, celles évidemment de la Mafia à la manière des Affranchis et du Parrain, mais surtout celle de Enersto Perez, homme de main cubain et tueur implacable au service de la Mafia. Mais c’est loin d’être une énième histoire de Cosa Nostra italienne, due en grande partie à la virtuosité de l’auteur R.J. Ellory pour nous faire traverser cette formidable épopée au cœur du crime organisé et surtout à la confession courant sur prés de 50 ans de Ernesto, tueur impitoyable, psychopathe mais cultivé, loyal et avec un sens aigüe de la famille, la sienne avant tout. Son confesseur, Ray Hartmann, est un peu comme nous, lecteurs, tantôt subjugué par cet homme et ses paradoxes, tantôt écœuré et horrifié par ses actes au sein de la Mafia. Il est aussi question d’absolution, de rédemption, de choix, de responsabilité et de déterminisme :
Les circonstances conditionnent-elles nos actes et nos décisions ou avons nous in fine le pouvoir de tordre la fatalité des destins ?
R.J. Ellory y répond de façon brillante, au fil de ce pavé retraçant une histoire de la Mafia italienne et du crime organisé aux États-Unis des années 50 à nos jours. On y croise les grandes figures de New York, Chicago ou Miami, des noms connus tels que Jimmy Hoffa, Marilyn Monroe ou Franck Sinatra mais on s’attache, un peu à contre-cœur, à ce tueur à gages qui décrit par le menu, le quotidien des hommes de main, des décisions des capos et autre lieutenants, des meurtres et intimidations, des accords inter-mafia en commençant par son tout premier meurtre à l’age de 13 ans dans sa Nouvelle Orléans natale. J’ai eu parfois le sentiment de revoir Les Affranchis ou Casino, mais heureusement l’autre volet du livre avec le confesseur Ray Hartmann, flic alcoolique en proie à des déboires familiaux, vient nous rappeler la dure réalité de la condition humaine et sert de fil conducteur aux interrogations sur la responsabilité et notre destin.
Le rythme du livre reprend cette dualité entre épisodes du récit de Ernesto et introspections sur la quête de sens de la vie. Des rebondissements, de l’intrigue, de la corruption, de l’amour évidemment, familial et sexuel, de l’histoire et avec tous ces ingrédients, l’auteur a mijoté un plat que l’on ne peut s’empêcher de savourer au fil des pages, même si parfois l’arrière goût peut s’avérer plutôt amer. A déguster sans modération jusqu’à la dernière ligne, histoire de constater que la vengeance est effectivement un plat qui se mange froid mais dont le goût peut parfois surprendre.
A travers des rues misérables, à travers des allées enfumées où l’odeur acre de l’alcool brut flotte comme le fantôme de quelque été depuis longtemps évanoui ; devant ces devantures cabossées sur lesquelles des copeaux de plâtre et des torsades de peinture sale aux couleurs de mardis gras se détachent telles des dents cassées et des feuilles d’automne ; passant parmi la lie de l’humanité qui se rassemble ici et là au milieu des bouteilles enveloppées dans du papier brun et des feux dans des bidons d’acier, cherchant à profiter de la maigre générosité humaine là où elle se manifeste, partageant la bonne humeur et une piquette infâme, sur les trottoirs de ce district…
Chalmette, ici à La Nouvelle-Orléans. Le son de ce lieu : la cacophonie des interférences, les voix précipitées, le piano cadencé, les radios, les prostituées, les jeunes roulant des hanches au son d’un rap hypnotique. En tendant l’oreille, on entend les voix querelleuses jaillir des porches ou des perrons, l’innocence déjà meurtrie, défiée, insultée. Les grappes de bâtiments et d’immeubles d’habitation, coincées entre les rues et les trottoirs comme une préoccupation secondaire, la reprise inopportune d’un thème plus tôt abandonné, filant comme un archipel mal ficelé et négligé, s’étirant jusqu’à Arabi, enjambant la Chef Menteur Highway jusqu’au lac Pontchartrain où les gens semblent s’arrêter simplement parce que c’est là que la terre s’arrête.
Les visiteurs se demandent peut-être ce qui fait ce mélange fétide et malodorant de parfums, de sons, de rythmes humains tandis qu’ils survolent le canal du lac Borgne, le quartier d’affaires du Vieux Carré, les restaurants Ursuline et Tortorici, pour atteindre Gravier Street. Car ici le son des voix est puissant, riche, animé. Une vague d’agitation se propage au hasard, et une poignée de curieux est rassemblée le long d’une rue à sens unique, un couloir bordé d’allées qui descendent vers des parkings d’immeubles. Sans les gyrophares des voitures de patrouille, la ruelle serait chaude et plongée dans une obscurité épaisse. L’arrière des voitures – ailes chromées et peintures satinées – capture les scintillements kaléidoscopiques, et les yeux écarquillés virent du rouge cerise au bleu saphir à mesure que les voitures de police se positionnent en travers de la rue et bloquent tout passage. A gauche et à droite se trouvent des hôpitaux, celui des anciens combattants et le centre universitaire, et devant se dresse le pont de South Claiborne Avenue, mais il règne ici, parmi le réseau d’artères et de veines dont le flot s’écoule d’ordinaire sans entraves, une certaine activité et personne ne sait ce qui se passe. Les agents font reculer les badauds en quête de sensations fortes, les entassant derrière une barrière érigée à la hâte, et lorsqu’une lampe à arc dont le faisceau est suffisamment large pour permettre d’identifier le moindre véhicule garé dans l’allée est fixée au toit d’une voiture, les curieux commencent à comprendre la source de cette soudaine présence policière. Un chien du voisinage se met à aboyer et, comme en écho, trois ou quatre autres se joignent à lui quelque part sur la droite. Ils hurlent à l’unisson pour des raisons connues d’eux seuls. Au niveau de la troisième entrée en partant de Claiborne Avenue, une voiture mal garée rompt l’alignement formé par les autres véhicules. Sa position indique qu’elle a été stationnée à la hâte, ou peut-être que son chauffeur se moquait d’être en harmonie avec la perspective et la conformité linéaire ; et bien que le laveur de voitures qui arpente cette allée – entretenant les automobiles, polissant phares et capots pour vingt-cinq cents de pourboire – ait vu cette voiture trois jours d’affilée, il a attendu de regarder à l’intérieur avant d’appeler la police. Muni d’une bonne lampe torche, il a collé son visage au déflecteur arrière gauche et inspecté le luxueux intérieur, prenant soin de ne pas toucher les flancs blancs des pneus avec ses sales godasses trouées. Ce n’était pas une voiture ordinaire. Quelque chose en elle l’avait attiré. De nouveaux badauds étaient arrivés, et environ une demi-rue plus loin, des gens avaient ouvert les fenêtres et les portes d’une maison où une fête était donnée, laissant s’en échapper de la musique et une odeur de poulet frit et de noix de pécan grillées, et lorsqu’une Buick banalisée arriva et qu’un homme du bureau du légiste en descendit et s’approcha de l’allée, la foule commençait à être conséquente : peut-être vingt-cinq personnes, peut-être trente. Et la musique – nos syncopes humaines – était aussi bonne ce soir-là que les autres soirs. L’odeur de poulet rappela à l’homme un endroit, une époque qu’il n’arriva pas à identifier sur le coup, et il se mit alors à pleuvoir paresseusement, une pluie de fin d’été qui ne semblait rien mouiller, le genre de pluie dont personne n’avait envie de se plaindre. L’été avait été torride, une sorte de douce violence, et tout le monde se souvenait de la puanteur lorsque les collecteurs avaient refoulé l’eau de pluie la dernière semaine de juillet et que celle-ci avait débordé dans les caniveaux. Elle s’était évaporée, les mouches étaient arrivées, et les gosses qui jouaient dans la rue étaient tombés malades. La température avait grimpé jusqu’à trente-deux, puis trente-cinq, et quand elle avait atteint les trente-huit degrés et que les habitants avaient eu les poumons si desséchés qu’ils n’arrivaient plus à respirer, ça avait été un vrai cauchemar, et ils avaient cessé d’aller au travail pour rester chez eux à prendre des douches ou rester allongés par terre, la tête recouverte jusqu’aux yeux de serviettes humides pliées et remplies de glace pilée. L’homme du bureau du légiste approcha. D’une petite quarantaine d’années, son nom était Jim Emerson ; il aimait collectionner les cartes de baseball et regarder les films des Marx Brothers, mais il passait le reste de son temps accroupi auprès de cadavres, tentant de tirer des conclusions. Il avait l’air aussi paresseux que la pluie, et on sentait à sa façon de se déplacer qu’il savait qu’il n’était pas le bienvenu. Il ne connaissait rien aux voitures, mais ils effectueraient une recherche le lendemain matin et découvriraient – comme l’avait deviné le laveur de voitures – que ce n’était pas un véhicule ordinaire.
Une Mercury Turnpike Cruiser, construite par Ford sous le nom de XM en 1956, commercialisée en 1957. Moteur V8, deux cent quatre-vingt-dix chevaux à quatre mille six cents tours minute, transmission Merc-O-Matic, trois mètres dix d’empattement, mille neuf cent vingt kilos. Celle-ci était l’un des seize mille modèles construits avec un toit rigide, mais elle arborait des plaques de Louisiane – plaques qui auraient dû se trouver sur une Chrysler Valiant de 1969 qui avait reçu sa dernière contravention pour une infraction mineure à Brookhaven, Mississippi, sept ans plus tôt.
